 Les nouvelles éditions Scala publient 5 volumes de 80 pages – petits formats à mettre dans la poche, joliment illustrés de photos couleurs – pour tenter de définir les « principes du regard » sur l’art chorégraphique. Proposé par Philippe Verrièle, journaliste et critique de danse, ce cycle de réflexion s’adresse tant aux praticiens qu’aux spectateurs amateurs en quête de clés de compréhension, à travers 5 questions : « Qu’est-ce que la danse ? » « Qu’est-ce qu’un chorégraphe ? » « Qu’est-ce qu’un danseur ? » « Quel sens a la danse ? » « Peut-on écrire la danse ? »
Les nouvelles éditions Scala publient 5 volumes de 80 pages – petits formats à mettre dans la poche, joliment illustrés de photos couleurs – pour tenter de définir les « principes du regard » sur l’art chorégraphique. Proposé par Philippe Verrièle, journaliste et critique de danse, ce cycle de réflexion s’adresse tant aux praticiens qu’aux spectateurs amateurs en quête de clés de compréhension, à travers 5 questions : « Qu’est-ce que la danse ? » « Qu’est-ce qu’un chorégraphe ? » « Qu’est-ce qu’un danseur ? » « Quel sens a la danse ? » « Peut-on écrire la danse ? »
Dans le premier volume, « Qu’est-ce que la danse » l’auteur – qui fréquente les salles de spectacle depuis de nombreuses années – dit, en guise de Prélude, que le regard posé sur la danse ne peut se comparer à rien d’autre : ni au théâtre, ni à la musique, ni au tableau, sous peine de décevoir : « La danse n’a rien d’autre à promettre que d’être la danse. » Il se défie des mots qui bien souvent ont « usé d’une terminologie confuse et mal définie » l’art de la danse, et prend beaucoup de précaution pour nommer les choses. Si la danse est partout, son économie reste fragile et Verrièle cherche à définir ce « domaine de compétence unique qu’aucune autre forme ne remplace » à travers de nombreux chorégraphes et tous styles de danse, distinguant trois étapes : la Danse, qui est pulsion ; le Danser, qui est action et s’inscrit dans le rapport à autrui ; le Chorégraphier, qui est l’acte artistique. Et il parle des patterns qui « constituent ces moments de danse que le chorégraphe retient, de différentes techniques comme la danse indienne « aux gestuelles codées très sophistiquées », de la double contrainte dans le film d’Akira Kurosawa, Kagemusha ; du mime d’Etienne Decroux et de Lecoq, pour conclure « L’univers de la danse commence donc là où les mots font défaut. » ? Dans la seconde partie de l’ouvrage il pose la question : « Qu’est-ce qu’une œuvre dansée ? »
Dans le second volume, à question apparemment simple qu’il pose : « Qu’est-ce qu’un chorégraphe ? » Philippe Verrièle donne une première réponse, d’attente : « Le plus simple tient à tenir pour chorégraphe celui qui fait la danse. » Or il remet en question le verbe faire et ajoute : « Mais la danse ne se fait pas, elle sourd de chacun d’entre nous… » et le danseur n’est-il pas le véritable auteur de la danse ? L’auteur parle des indiscutables chorégraphes, Jérôme Robbins, Merce Cunningham, Pina Bausch, Maurice Béjart qui a « changé le rapport du grand public à la figure du créateur de ballet. » Il lie le concept de chorégraphe à celui de la notation en danse et rappelle que « ce n’est qu’en 1973 que la SACD accepte que le chorégraphe puisse être l’auteur 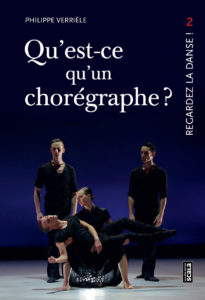 du ballet et en touche les droits, sans contestation » ce furent pendant longtemps les compositeurs de musique jusqu’à l’affirmation par les Ballets Russes du triumvirat compositeur, peintre, maître de ballet alors que l’ultime polémique s’est jouée entre le musicien et le maître de ballet. Certains artistes pourtant n’ont pas créé de hiérarchie entre les disciplines, c’est le cas entre Merce Cunningham et John Cage, et la diversification des musiques donc la fin de l’œuvre unique ont fini par clarifier les choses. Dans la seconde partie de l’ouvrage, Philippe Verrièle interroge aussi la notion de représentation, les solos et les performances et, démontrant sa plasticité, pose la question : « Comment représenter l’œuvre dansée ? »
du ballet et en touche les droits, sans contestation » ce furent pendant longtemps les compositeurs de musique jusqu’à l’affirmation par les Ballets Russes du triumvirat compositeur, peintre, maître de ballet alors que l’ultime polémique s’est jouée entre le musicien et le maître de ballet. Certains artistes pourtant n’ont pas créé de hiérarchie entre les disciplines, c’est le cas entre Merce Cunningham et John Cage, et la diversification des musiques donc la fin de l’œuvre unique ont fini par clarifier les choses. Dans la seconde partie de l’ouvrage, Philippe Verrièle interroge aussi la notion de représentation, les solos et les performances et, démontrant sa plasticité, pose la question : « Comment représenter l’œuvre dansée ? »
Le volume numéro 3, « Qu’est-ce qu’un danseur » cherche à définir l’étrangeté du danseur, sachant qu’il est avant tout un humain qui danse. « Le danseur obsède la danse pour cette raison définitive qu’il est objectivement obsédant » dit l’auteur, les mots sont forts mais vrais, on peut dire que la mythologie autour de la beauté nous hante. A la question : « Tout le monde serait-il potentiellement danseur ? » Philippe Verrièle répond que nous serions tous plutôt potentiellement dansants et il interroge la frontière entre amateur et professionnel, qu’il place au niveau de la réalisation. « Cela va plus vite, plus haut, plus fort. Cela dégage une émotion plus perceptible, plus puissante, plus rare » dit-il même si certains chorégraphes cherchent à « gommer la limite entre pratique sociale et réalisation artistique. » C’est le cas de Mathilde Monnier dans Publique, Jérôme Bel dans The show must go on ou encore les soirées What you want de Thomas Lebrun. La nature du danseur, cet « athlète de l’art » reste mystérieuse et il est des danseurs qui, s’ils sont sur le plateau et ne dansent pas ou très peu, restent bien des danseurs, ainsi Bandonéon de Pina Bausch, ou Duet de Paul Taylor. Il y a par ailleurs des courants, pour ne pas dire des modes, comme la période de la non-danse dans les années 1990/2000. Et même quand le texte s’invite dans la danse, le danseur danse les mots et ne les interprète pas comme le ferait l’acteur. Verrièle fait quelques survols historiques quant à l’émergence de la danse professionnelle et regarde l’interaction de la danse avec les autres arts et leurs interférences : avec le texte, le cirque, la performance. La seconde partie de l’ouvrage porte pour titre : « Apologie du cours de danse (Qu’est-ce qu’un danseur gros ?) » il y montre que « le studio de danse concentre une part déterminante de l’imaginaire associé à la danse et porte quelque chose de l’éternité » que le cours – qui n’est pas seulement le travail à la barre – rythme les journées des danseurs. Il nomme les trois particularités des cours de danse : la continuité, le professeur de danse et la collectivité, et conclut que la notion de danseur au final reste floue puisque l’on se nomme surtout danseur par auto-désignation. Ce volume 3 de la série Regardez la danse ! se ferme avec L’ineffable et le danseur, faisant référence à l’ouvrage du philosophe Vladimir Jankélévitch La Musique et l’Ineffable : « L’interprétation tient dans cette création dans l’instant de ce qui existe déjà qui n’est pas une reproduction, mais bien une création vraie, aussi magique que la première, parce qu’elle ne s’appuie pas sur la composition ou l’élaboration de l’œuvre dansée. Elle donne à appréhender d’une façon sinon nouvelle du moins inattendue à ce moment la texture même du mouvement dansé. »
danseurs, ainsi Bandonéon de Pina Bausch, ou Duet de Paul Taylor. Il y a par ailleurs des courants, pour ne pas dire des modes, comme la période de la non-danse dans les années 1990/2000. Et même quand le texte s’invite dans la danse, le danseur danse les mots et ne les interprète pas comme le ferait l’acteur. Verrièle fait quelques survols historiques quant à l’émergence de la danse professionnelle et regarde l’interaction de la danse avec les autres arts et leurs interférences : avec le texte, le cirque, la performance. La seconde partie de l’ouvrage porte pour titre : « Apologie du cours de danse (Qu’est-ce qu’un danseur gros ?) » il y montre que « le studio de danse concentre une part déterminante de l’imaginaire associé à la danse et porte quelque chose de l’éternité » que le cours – qui n’est pas seulement le travail à la barre – rythme les journées des danseurs. Il nomme les trois particularités des cours de danse : la continuité, le professeur de danse et la collectivité, et conclut que la notion de danseur au final reste floue puisque l’on se nomme surtout danseur par auto-désignation. Ce volume 3 de la série Regardez la danse ! se ferme avec L’ineffable et le danseur, faisant référence à l’ouvrage du philosophe Vladimir Jankélévitch La Musique et l’Ineffable : « L’interprétation tient dans cette création dans l’instant de ce qui existe déjà qui n’est pas une reproduction, mais bien une création vraie, aussi magique que la première, parce qu’elle ne s’appuie pas sur la composition ou l’élaboration de l’œuvre dansée. Elle donne à appréhender d’une façon sinon nouvelle du moins inattendue à ce moment la texture même du mouvement dansé. »
 « Quel sens a la danse ? » pose le 4ème volume, question déterminante pour le spectateur. Repartant de la question de la nature de la danse, Philippe Verrièle recentre le sujet sur l’écart entre le théâtre et la danse, le metteur en scène et le chorégraphe, prenant notamment pour exemple Jan Lauwers avec La Chambre d’Isabelle et la grande liberté de certains comme William Forsythe ou Trisha Brown qui mènent des aventures hors catégorie. Il démontre que quand il y a confusion entre le théâtre et la danse, le spectateur erre dans la même confusion. Par ailleurs, pour lui la danse-théâtre n’existe pas. Et il s’appuie sur Sacha Waltz avec Travelogue et regarde longuement le concept du Tanztheater de Pina Bausch. « Cette question du Tanztheater n’a rien d’une petite dispute entre spécialistes sur la nomenclature des styles. Elle illustre une difficulté majeure de la danse : celle-ci est à la fois abstraite et concrète. Et cela joue naturellement sur la perception que l’on peut en avoir. » Pour Verrièle, « cette question du sens de la danse traduit en effet très clairement la prééminence du livre et de la littérature dans notre culture » et il fait le lien avec le XVIIIème siècle au moment où « le grand ballet de cour est passé de mode » et où « le spectateur veut autre chose. » La seconde question posée par l’auteur dans ce volume, question en apparence bien inutile comme il le dit lui-même : « Faut-il faire de la danse pour en parler ? » le mène à parler de virtuosité et d’élitisme.
« Quel sens a la danse ? » pose le 4ème volume, question déterminante pour le spectateur. Repartant de la question de la nature de la danse, Philippe Verrièle recentre le sujet sur l’écart entre le théâtre et la danse, le metteur en scène et le chorégraphe, prenant notamment pour exemple Jan Lauwers avec La Chambre d’Isabelle et la grande liberté de certains comme William Forsythe ou Trisha Brown qui mènent des aventures hors catégorie. Il démontre que quand il y a confusion entre le théâtre et la danse, le spectateur erre dans la même confusion. Par ailleurs, pour lui la danse-théâtre n’existe pas. Et il s’appuie sur Sacha Waltz avec Travelogue et regarde longuement le concept du Tanztheater de Pina Bausch. « Cette question du Tanztheater n’a rien d’une petite dispute entre spécialistes sur la nomenclature des styles. Elle illustre une difficulté majeure de la danse : celle-ci est à la fois abstraite et concrète. Et cela joue naturellement sur la perception que l’on peut en avoir. » Pour Verrièle, « cette question du sens de la danse traduit en effet très clairement la prééminence du livre et de la littérature dans notre culture » et il fait le lien avec le XVIIIème siècle au moment où « le grand ballet de cour est passé de mode » et où « le spectateur veut autre chose. » La seconde question posée par l’auteur dans ce volume, question en apparence bien inutile comme il le dit lui-même : « Faut-il faire de la danse pour en parler ? » le mène à parler de virtuosité et d’élitisme.
Dans le volume numéro 5 et dernier de la série, Philippe Verrièle s’attaque à une question complexe : « Peut-on écrire la danse ? » Parlant des écritures de la danse, il énonce un premier constat : même si « elles offrent des outils très performants, rares sont les chorégraphes qui les utilisent pour la conservation de leurs œuvres » l’exception étant Angelin Preljocaj qui invite, depuis ses débuts, une notatrice de la méthode Benesch à le suivre dans l’élaboration de ses créations. Second constat, les chorégraphes ne notent pas, en amont à leur travail, la pièce qu’ils élaborent. Ils prennent par contre souvent crayon ou stylo pour créer un univers plastique, qu’eux seuls décodent et qui n’est pas voué à la postérité. Entre connaissance physique et posture intellectuelle, il existerait un fossé dans la fantasmatique des chorégraphes. « Accepter la notation revient à concéder l’existence à l’œuvre dansée en dehors de son créateur, et cela ne va pas du tout de soi. » Écriture ou notation ? Telle est la question avec, souvent, des confusions. L’écriture se superpose en général au style, ou au genre tandis que la notation suit celle de la codification du mouvement. Ce sont les maîtres à danser qui se sont intéressés les premiers au système de notation : Pierre Beauchamp au début du siècle des Lumières, le XVIIIème et qui a débuté à la cour de Louis XIV, suivi de son élève Raoul-Auger Feuillet qui perfectionne le système pour la danse baroque. Pourtant ses limites montrent que le système ne s’applique qu’au bas du corps, qu’il est mal adapté aux mouvements d’ensemble et qu’il ne sert que la danse d’Académie. Beaucoup d’autres formes de notation sont élaborées au XIXème dont celle de Vladimir Stepanov pour les Ballets Petipa en Russie, mais aucune ne s’impose. Il faut attendre le début du XXème pour que deux systèmes voient le jour : le premier, publié par Rudolph Laban en 1928, s’appuie sur quatre éléments – le temps, l’espace, le poids et la force ; le second, publié par Rudolph Benesh en 1955 s’apparente à une partition musicale et part de la position du corps dans l’espace. La notation a et garde ses détracteurs, ainsi Roland Petit disant : « Mais noter, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je pense que la chorégraphie d’aujourd’hui ne peut pas être écrite. » Écriture et notation ne sont ni la grammaire ni le vocabulaire de la danse. Dans la seconde partie de ce dernier volume : « La danse a-t-elle une mémoire ? » Philippe Verrièle démontre que « Trop ou trop peu, la mémoire de la danse ne trouve jamais le bon réglage » et s’insurge contre l’idée d’éphémère défendue par certains, ne serait-ce qu’en raison du jeu des références, de la citation ou de l’histoire de la danse questionnée par les chorégraphes.
C’est un éblouissant parcours que propose au lecteur Philippe Verrièle, à travers ces cinq volumes. Son observation, sa réflexion tant par l’histoire de la danse que dans la contemporanéité des formes et styles, ses interrogations, sa brillante connaissance du sujet, appellent admiration et félicitations. Avec cette traversée sans escale il fait danser les mots et tourner les pages de la collection Regardez la danse ! invitant à une plongée dans l’univers des chorégraphes et des danseurs, dans celui de la danse, intense, ardente et transcendante.
Chapeau bas aux nouvelles éditions Scala, simples et belles, à la riche iconographie, une mine pour ceux qui, de loin ou de près, s’intéressent au mouvement, à l’espace-temps, au corps, au dépassement, à la danse.
Brigitte Rémer, le 15 août 2019
5 volumes de Philippe Verrièle, publiés aux nouvelles éditions Scala : « Qu’est-ce que la danse ? » – « Qu’est-ce qu’un chorégraphe ? » – « Qu’est-ce qu’un danseur ? » – « Quel sens a la danse ? » – « Peut-on écrire la danse ? » – Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Site : www.editions-scala.fr (8 euros le volume).









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.